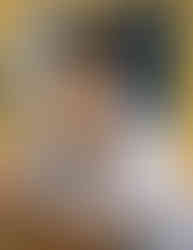JULIE ANDREWS
- Céline Colassin
- 15 mai 2024
- 21 min de lecture

Le mois d’Octobre 1935 fut particulièrement agité. Mussolini partait en guerre à la fois contre l’Ethiopie et contre les intérêts britanniques en Afrique. Le Négus était contraint à l’exil.
Le premier jour de ce même mois d’octobre 1935, naissait à Walton of Thames dans la banlieue du grand Londres, Julia Elizabeth Wells. Fille de Barbara et Edward Charles. Aimable famille de la middle class anglaise. Edwards enseigne les techniques professionnelles des métiers du bois et du fer. Barbara qui a oublié pour un temps ses ambitions artistiques reste au foyer avec ses deux enfants. Julia est nantie d’un frère : John. Cette nouvelle venue sur cette planète en pleine agitation est loin de se douter qu’elle est la cause pourtant innocente de la mésentente qui s’installe entre ses parents et qui finira par les pousser au divorce.
Elle ignorera tout de cette ténébreuse affaire matrimoniale, sa mère ayant décidé d’attendre qu’elle ait 15 ans et qu’elle soit « en âge de comprendre » pour lui faire ses révélations fumantes. Julia n’est pas la fille de son père mais le résultat malencontreux d’une liaison de Barbara avec un amant dont elle gardera jalousement l’identité secrète. C’est que voyez vous c’était un « ami de la famille » et l’adultère se doublait donc d’une « trahison généralisée »
Voilà de quoi chambouler cette tête juvénile !
Julia vécut d’abord avec son frère chez son père comme l’avaient prévu les clauses du divorce. C’était la guerre. Londres flambait sous un tapis de bombes, Julia avait huit ans et son père l’hébergeait alors loin de la capitale dévastée avec son frère John. Mais daddy va très vite décider de renvoyer sa progéniture chez son ex épouse. Entretemps, Barbara s’était remariée avec monsieur Ted Andrews en 1943. Elle avait rencontré Ted Andrews en divertissant les troupes au sol entre deux alertes meurtrières.
Edwards avait renvoyé sa fille chez son épouse prétextant que la petite semblait avoir certains dons artistiques et puisque madame prétendait maintenant « se produire », elle serait à même de prodiguer à l’enfant une éducation mieux adaptée à son cas. Peut-être que l’exacte vérité est aussi à chercher du côté de sa rencontre avec celle qui sera sa prochaine épouse, une coiffeuse momentanément recyclée dans une usine d’armement. L’effort de guerre c’est pour tout le monde.
Un autre point étant à prendre en considération est que madame mère et son nouveau mari ne roulent pas sur l’or et que se loger dans Londres dévastée relève de l’impossible. Le couple a de la chance d’avoir trouvé un gourbi vacant avec un placard et une paillasse dedans pour l’artiste en herbe. Laquelle peut à juste titre trouver sa situation des plus alambiquées puisque sa mère ne veut pas qu’elle appelle son beau-père « Oncle Ted » ni « papa » puisqu’un père elle en a un. Donc ce sera « Pop ». Oncle Ted étant Pop et papa n’étant en fait pas papa. C’est vrai, c’est compliqué. Et compliqué encore d’autant qu’oncle Pop supportant mal la situation précaire du moment a une fâcheuse tendance à la picole, à la torgnole et à venir voir d‘un peu plus près cette jeune oiselle dans son placard. Julia s’achètera un verrou avec ses premières économies sur quelques vagues étrennes de Noël. On se croirait déjà dans un film de Mary Pickford !
Fort heureusement pour ce qu’il reste de Londres et de ses habitants, la guerre finira. Le couple Andrews qui avait gagné une certaine réputation sous les bombes n’aura pas grand mal à trouver des engagements et la situation financière va rapidement s’améliorer. On pourra quitter le gourbi pour un logement plus décent. Ted Andrews pourra finalement avoir sa revanche sur la vie lorsqu’il sera devenu assez riche pur racheter l’élégante demeure où sa grand’mère avait été boniche jadis. Il semble également que le retour à une situation financière acceptable avant d’être aisée ait calmé ses fureurs nocturnes envers Julia. Il semble même qu’en guise d’aveu de repentance, Ted Andrews ait financé les études musicales de sa belle-fille chez de très renommés et distingués professeur. L’une d’entre elles, Lilian Stiles-Allen se souviendra de sa prestigieuse élève dans ses mémoires : « La justesse et la précision qu’elle avait m’ont d’emblée étonnée et puis j’ai découvert qu’elle avait le sens extrêmement rare et précieux de la hauteur absolue ! » Julie Andrews lui répondra par mémoires interposées : « C’est très exagéré ! Mais c’est vrai que j’ai une voix assez claire et assez pure, avec ma capacité qui couvre quatre octaves, je faisais le régal de tous les chiens du quartier quand je poussais la note. »
Julie a dix ans et suit une scolarité très honorable en parallèle de ses études musicales lorsqu’un jour après l’école sa mère l’envoie « immédiatement au lit » . Ce n’est pas une punition. Le soir, pour la première fois Julie se produira sur scène avec sa mère et « Pop » puisque « Pop » il y a. Il faut qu’elle soit en forme ! Si elle se voyait déjà descendant un grand escalier, couverte de plumes et de diamants comme aux « Folies Bergères », elle en fut pour ses frais.
Pop chantait, sa mère l’accompagnait au piano et Julie vint pousser quelques duos avec Pop, juchée sur un casier de bières retourné pour atteindre l’unique micro. Plus tard, le succès faisant, elle aura droit à deux ou trois soli.
Le monde a toujours adoré les petites filles qui chantent. Celle-ci chantait juste, elle avait une bonne tête elle était toute proprette et la guerre était finie. Que demander de plus ?
Pop Andrews est loin d’être un nigaud et a parfaitement décelé le potentiel de sa belle-fille. C’est lui qui va « faire l’article », la présenter, la promouvoir et son insistance va payer.
En 1947, Julie est engagée pour un numéro au London Hippodrome. Le London Hippodrome avait été inauguré en 1900 et devait son nom et son succès à ses spectacles d’animaux pour lesquels il avait été pensé. En 1947, le public s’est entiché de Wally Boag, un fantaisiste américain qui donne son spectacle tout en fabriquant des animaux avec des ballons. A la fin de son numéro, il tenait en main sa plus belle création et lançait au public : « Y a-t-il un enfant dans la salle à qui ceci ferait plaisir ? » Une petite fille de 12 ans se précipitait alors en disant « Oh moi, s’il vous plaît ! » Wally l’invitait sur scène, lui offrait son œuvre et lui faisait une petite interview à la Jacques Martin « Comment tu t’appelles ? Tu as quel âge ? Qu’est-ce que tu veux faire plus tard ? » Et comme elle avouait rougissante qu’elle aimerait chanter, Wally l’invitait à montrer ce dont elle était capable. Après avoir minaudé pour la crédibilité de l’ensemble elle se lançait dans le grand air de l’opéra-comique « Mignon », « Je Suis Titana » pour un public subjugué qui la portait chaque soir au triomphe ! On l’a compris cette petite fille innocente désignée au hasard dans le public, c’est Julie tous les soirs. L’air nécessite la tessiture d’une soprano coloratur, Maria Callas s’en fera d’ailleurs l’interprète. Nul doute que le public du London Hippodrome devait être complètement chamboulé d’entendre ces vocalises de haute voltige sortir d’un gosier enfantin.
Cette petite saynète va se donner tout un an avec un succès tonitruant et jamais démenti. Wally Boag qui fera bientôt les grandes heures de Disneyland jurera toute sa vie que le premier soir, Julie était vraiment une spectatrice comme les autres. Le 1 Novembre 1948, le succès de Julie à l’Hippodrome est tel qu’elle figure parmi les artistes qui se produisent au Palladium devant la famille royale d’Angleterre. Elle a 13 ans et est invitée d’honneur avec Danny Kaye et les Nicholas Brothers.
Ce soir-là, tout divorcés qu’ils soient ses parents étaient vissés devant leur téléviseur respectif, pleurnichant à qui mieux mieux devant le spectacle retransmis en direct. Et en 1948 qui dit télévision en Angleterre dit BBC. Laquelle BBC va lui mettre le grappin dessus ! Elle s’y produira régulièrement jusqu’en 1952, souvent avec sa mère et « Pop » pour accentuer l’effet « petite fille ». Mais la juvénile vedette n’est pas qu’une curiosité de petit écran. Elle mène déjà une carrière très fructueuse au théâtre et l’Angleterre mit paraît-il des années à se remettre de l’émotion qu’elle prodigua en emmenant « Cendrillon » en tourne à travers tout le pays avant que de triompher une fois encore à Londres. Presque une habitude, déjà.
Le 30 Septembre 1954 est une date événement dans la vie de Julie Andrews. Le lendemain elle aura 19 ans, mais ce soir-là, l’ultime soir de ses 18 ans, le rideau va se lever pour la première fois devant le public de Broadway ! Julie donne tout ce qu’elle peut dans la comédie musicale « The Boy Friend » et une fois encore c’est le triomphe ! Un an sold-out et une option pour le rôle d’Elisa Doolittle dans « My Fair Lady ». Un rôle qu’elle obtient haut la main au côté de l’ineffable et plutôt irascible Rex Harrison en professeur Higgins. Le soir de la première, Julie était tremblante de trac et Rex Harrison faisait une petite bouderie, enfermé dans sa loge, glapissant qu’il n’entrerait pas en scène ! Un rôle qu’elle obtient et qui déchaîne d’emblée la presse New-Yorkaises spécialisée. Julie était réclamée à cor et à cris pour « The Pipe Dream ».
Toutes les stars de Broadway se seraient damnées pour un des deux rôles et Julie n’avait pour seul souci que de se décider pour l’un ou l’autre ! En attendant son auguste décision, tout était « suspendu » on n’auditionnait plus personne.
Lorsqu’elle choisit « My Fair Lady » évidemment, la moitié de la presse loua son génie et l’autre s’affola d’une bévue qui allait lui coûter sa carrière. « The Pipe Dream » était disait-on un spectacle beaucoup plus prometteur de triomphe que cette resucée de « Pygmalion ». D’ailleurs et tout le monde le savait, la production avait souhaité Mary Martin et Noël Coward. Lesquels, plus avisés, avaient sagement refusé. C’est d’ailleurs Mary Martin qui lançant le texte à la figure de ses auteurs persifla « Faites en plutôt un musical, ça marchera peut-être ! » Force est de constater que Mary avait bel et bien raison et les détracteurs de Julie avaient bel et bien tort.
Non seulement personne ne se souvient d’Helen Traubel qui obtint le rôle de « Pipe Dream » mais « My Fair Lady » connut le succès le plus fulgurant et le plus long de Broadway !
Julie et Rex joueront Eliza et Higgins 2717 fois entre Londres et Broadway.
Un triomphe tel que Julie Andrews avait presque oublié qu’elle avait signé pour reprendre à la télévision son rôle de « Cendrillon » Le spectacle diffusé en direct en mars 1957 réunira 107 millions de téléspectateurs. Evidemment, le triomphe de « la comédie musicale parfaite » ne pouvait laisser Hollywood indifférent. C’est Jack Warner qui le premier obtiendra les droits. Les plus chers de toute l’histoire. Warner voulait Cary Grant dans le rôle mais l’acteur qui avait vu le spectacle à Broadway envoya un télégramme historique à Jack Warner : « Non seulement je ne veux pas de ce rôle mais si vous ne le donnez pas à Rex Harrison, je ne tournerai plus jamais aucun film pour votre studio ! » Warner s’inclina et advint alors ce que personne n’avait imaginé. La Warner choisit Audrey Hepburn pour le rôle d’Eliza.
Julie Andrews n’avait encore jamais vendu un seul ticket de cinéma. Le film avait déjà engouffré des millions avant même que les caméras ne soient chargées. Il ne pouvait pas prendre un tel risque alors qu’Audrey n’avait fait aucun flop et conduit tous ses films au succès.
Ce fut un scandale absolu. Le jour de l’annonce à la presse de la mise en chantier du projet, Warner fit son discours sous les huées et Audrey souriait de toutes ses dents en tremblant comme une feuille morte de chez Givenchy dans un cyclone. Tétanisée d’effroi elle sera incapable de dire un mot.
La polémique enfla jusqu’à l’invraisemblable ! Comment pouvait-on spolier Julie Andrews de SON rôle au profit d’une actrice qui ne savait pas chanter ?
Or, non seulement Audrey savait chanter mais elle avait signé pour chanter dans le film. Elle faillit se tuer de répétitions. Elle a chanté tout son rôle jusqu’à l’épuisement de ses forces pour découvrir le soir de la première que Jack Warner l’avait fait doubler en secret par Marni Nixon.
Julie Andrews fit bonne figure et aucun commentaire. Elle allait d’ailleurs avaler une autre couleuvre encore bien plus visqueuse lorsque son rôle dans « The Boy Friend » serait confié à Twiggy, mannequin sans expérience cinématographique ne sachant pour le coup ni chanter ni danser ni jouer !
Audrey de son côté, bien que dépitée, fit un triomphe absolu dans My Fair Lady.
Mais Julie Andrews n’allait pas rester sur le carreau.
Bon papa Disney veillait.
Il avait vu, comme toute l’Amérique, Julie dans « My Fair lady » et complètement subjugué avait décidé séance tenante de la faire débuter au cinéma. Son studio s’apprête justement à mettre en chantier un nouveau film bourré d’effets spéciaux encore jamais vus : Mary Poppins. Disney connaît la réputation de Julie Andrews depuis le coup des ballons à l’Hippodrome de Londres. Son studio fait plus que nulle part ailleurs grande consommation d’enfants surdoués et il s’était également rendu personnellement à Broadway la voir dans « Camelot » avec Richard Burton. Encore un rôle qui lui échappera à l’écran.
L’occasion ne s’était pas présentée d’engager Julie Andrews enfant .Mais là elle était inespérée bien que devenue adulte. Avec la polémique « My Fair Lady » elle était la femme dont on parlait le plus dans les milieux du cinéma. Le public brûlait de la voir à l’écran. Disney se rua avec le contrat « Mary Poppins » entre ses doigts d’or. Il vint en personne à la rencontre de Julie et pour la convaincre, il lui fit écouter la musique déjà composée pour le film, lui montra le Story Board et les esquisses des costumes.
Mais il y avait un hic ! Julie était encore adolescente lorsqu’elle avait rencontré un certain Tony Walton, son premier amour. En 1959 ils avaient légalisé leur tendre amour de jeunesse et lorsque Disney se précipita avec son contrat, la très parfaite édouardienne Mary Poppins était enceinte jusqu’aux narines ce qui aurait fait convenons en très mauvais genre ! Disney s’inclina et d’un baisemain déclara : « Ne vous inquiétez pas ma chère, nous vous attendrons ! Signez ici ! » C’est donc après la naissance de sa fille Emma Kate que Julie endossa la défroque de la nurse volante et devint Mary Poppins pour des générations d’enfants émerveillés. La pauvre Julie, de son côté se souviendrait longtemps du tournage : « J’ai passé la moitié du temps accrochée au plafond par des câbles et comme le film était bourré d’effets spéciaux, le tournage a duré deux fois plus longtemps que pour un autre film à part peut-être Cléopâtre ! J’ai passé des journées entières à attendre la mise au point technique d’un seul plan . »
Le triomphe de Mary Poppins, le plus gros succès du studio Disney valait bien un Oscar. Julie Andrews fut donc oscarisée dès son premier film même si ceux qui se targuent d’écrire la légende des coulisses hollywoodiennes jurent qu’il s’agissait d’un Oscar décerné surtout pour vexer Audrey Hepburn. C’est mal connaître à la fois la femme et l’histoire. Audrey Hepburn déjà oscarisée, elle aussi dès son premier film américain, ne se serait pas vexée pour une telle broutille. Ensuite encore, tout le monde l’adorait à Hollywood où strictement personne n’aurait songé à ourdir un complot pour la blesser de quelle manière que ce soit ! Julie Andrews ne doit son Oscar qu’à son travail et son talent et Audrey sera la première à la féliciter. My Fair Lady avait raflé les Oscar du meilleur film, meilleur acteur et meilleur metteur en scène. Audrey n’avait pas été nommée. Non pas pour faire plaisir à Mary Poppins mais parce qu’elle était doublée pour le chant. Julie Andrews évinçait donc Anne Bancroft, Sophia Loren, Debbie Reynolds et Kim Stanley mais en aucun cas Audrey Hepburn. Ainsi donc, Julie Andrews était devenue une de ces colossales et rarissimes superstars oscarisées d’emblée. Et pour celles-là, la suite est souvent bien plus dure et difficile que pour n’importe qui d’autre. Il faut bien tourner un deuxième film et il faut qu’il soit, c’est un minimum, à la hauteur du premier. Disney bien entendu fut le premier à la féliciter et lui proposer un autre film au tarif mirobolant d’un million de dollars. Disney se fit envoyer promener. Mary Poppins ne sortirait pas de son lit à moins d’un 1.250.000$. Ce qui permit à tonton Walt de méditer longtemps sur l’ingratitude des femmes et des actrices en particulier.
Quand le succès atteint de tels sommets, le public attend de revoir l’actrice mais il veut aussi retrouver son personnage. Ayons une pensée émue pour Barbra Streisand et Liza Minnelli qui ne sauront jamais faire mieux que « Funny Girl » et « Cabaret » Julie Andrews, par contre va réussir la gageure au-delà de toute vraisemblance avec « La Mélodie du Bonheur ». Le film en soi est une entreprise plutôt risquée: L’adaptation des mémoires de Maria Augusta Trapp. Lesquelles ont déjà été portées à l’écran en Allemagne par deux fois.
Maria Augusta Kutschera était une jeune novice de Salzbourg. Mais le climat lui convenant mal elle fut expédiée aux bons soins de la fille d’un aristocrate, militaire et veuf de son état. L’enfant de constitution fragile se remettait à peine d’une scarlatine. Bien qu’elle ne soit engagée que pour s’occuper de la cadette, Augusta va finir par s’occuper des 7 enfants du colonel Von Trapp. Le colonel, gai comme un éteignoir est loin d’avoir le charme de Christopher Plummer dans le film. Il a déjà renvoyé vingt-six nurses en quelques mois et Augusta va devoir s’accrocher durant quatre ans avant qu’il ne daigne être aimable. Il s’adoucira grâce à l’enseignement musical de grande qualité qu’Augusta dispense aux enfants. Augusta épousera le colonel sans amour mais pour rendre aux enfants une famille stable. Peu de temps après, Hitler annexera l’Autriche et les Trapp ruinés devront se contraindre à l’exil américain et se produiront sur scène pour vivre. La « Trapp Family » s’étant encore agrandie des enfants du couple. La réalité on le voit se prêtait on ne peut mieux à une adaptation filmée mais se posait le problème des chansons. Les Trapp n’étaient pas des petits rigolos et donnaient du Liszt et du Schubert, pas des comptines de cour d’école. La vie des Trapp est une histoire de mort, de solitude, de tristesse, de devoir et de discipline, de ruine et d’exil. En faire un joyeux spectacle de fête de Pâques est un pari plus qu’osé même en mettant de l’amour entre les personnages et en donnant Eleanor Parker en rivale à Julie Andrews.
Le projet était si risqué, si épouvantablement sucré que la Century Fox ne trouva…Personne pour le mettre en scène. Même Gene Kelly et Stanley Donen s’enfuirent en courant.
Pourtant le succès fut colossal et pour la première fois depuis 1939, nous étions en 1965, « Autant en Emporte le Vent » était dépassé au box-office. Bien des critiques s’ébouriffèrent devant tout le sucre que le public est capable d’avaler mais rien n’y fit. Le film était un triomphe colossal, bien supérieur encore à celui déjà fantastique de « May Poppins ». Une pluie d’Oscar s’abattit sur le film surnommé à Hollywood « La Mélodie du dollar ». Meilleur film, meilleur réalisateur, meilleur montage, meilleur son. Julie quant à elle, bien entendu nommée, sera évincée par Julie Christie pour « Darling ». Si elle ne fut pas oscarisée, elle reçut son second Golden Globe et l’année suivante elle en recevra un troisième pour être « La vedette la plus populaire du monde ».
A ce jour, sans cesse redistribué, sans cesse redécouvert, « La Mélodie du Bonheur » poursuit sur sa lancée et a engrangé des bénéfices de deux milliards deux cent soixante-cinq millions de dollars. Christopher Plummer ne peut donner une interview sans qu’on lui demande « Commet c’était de tourner avec Julie Andrews ? » Ce à quoi il répond invariablement « C’était comme de recevoir un coup sur la tête flanqué par une carte de Noël ! Ceci dit je suis tombé instantanément sous son charme comme tout le monde ».
Julie Andrews était devenue cette sorte de star dont Hollywood raffole entre toutes : une money maker ! Il allait falloir gâter, chouchouter l’oiseau rare, le rossignol en or massif. D’autant que si elle avait fait exploser tous les coffres forts avec deux comédies musicales, le genre on le savait périclitait et c’était risquer gros que de garder tous ses œufs dans le même panier doré.
Julie s’était trouvée propulsée dès 1966 dans le top 10 du box-office américain. Elle trône à la quatrième place. Et si Doris Day la devance encore à la troisième, elle laisse Elizabeth Taylor en personne loin derrière elle. Julie emportée par le tourbillon que devenait sa carrière envisagea de se chercher une maison à Beverly Hills. Jusque là elle ne croyait absolument pas à son avenir dans le cinéma et considérait sa carrière à l’écran pour le moins incertaine.
Même à Hollywood, même assis sur un Everest de dollars on se doute bien que le public ne va pas passer sa vie à bourse délier pour de telles pâtisseries chantantes. A côté de « La Mélodie du Bonheur », « Sissi impératrice » à l’air d’un thriller !
Et puis il y a un autre point de détail qui a sa très large importance. Miss Andrews est peut-être devenue une énorme star d’Hollywood mais elle était une star immense à Broadway. Elle reprendra « My Fair Lady » avec Rex Harrison à Broadway et le spectacle tiendra cinq ans et demi ! Dans ces conditions et ignorant le succès planétaire qu’allaient connaître ses deux films, l’actrice n’avait signé aucun contrat à long terme avec un studio quelconque. Elle n’était la propriété ni de Disney ni de la Century Fox. Dès lors, comme on s’en doute, c’était la foire d’empoigne à coup de chèques mirobolants entre les studios. C’était à qui parviendrait à faire signer l’idole des banquiers ! Dans le tourbillon doré qu’est devenue la vie de Julie, son mariage s’est défait. Elle a la garde d’Emma Kate et lorsque Tony Walton vient rendre visite à sa fille, madame est toujours absente de l’ex domicile conjugal.
C’est Universal qui va rafler la mise en faisant de la reine de la comédie musicale en sucre une héroïne d’Hitchcock dans « Le Rideau Déchiré ». C’était judicieux ! Le film faisait d’elle l’épouse de Paul Newman mais pas une blonde à la Grace Kelly ou à la Kim Novak. Elle serait une intellectuelle épouse fidèle, patriotique et suspicieuse. Ravie de tourner pour Hitchcock et avec Newman elle se rendra vite compte que seules les scènes de crime intéressent Hitch ! Lorsqu’elle lui demande de répéter ses scènes d’amour avec Paul Newman, exercice dont elle n’a pas l’habitude, Hitch l’envoie aimablement promener « Mais non, ce n’est pas nécessaire ma petite enfant, faites donc ce que vous voulez ! » Le film allait être un four absolu. Qu’est-ce qui n’a pas fonctionné, mystère. A revoir aujourd’hui, le « Rideau Déchiré » est plutôt un bon film et même s’il n’est pas le meilleur Hitchcock, le maître du suspense n’a pas eu à en rougir. Le scénario est bien ficelé et les interprètes tiennent la route même si pour appuyer son côté sérieux et intellectuel Julie Andrews grisonne de la mise en plis dans une garde-robe moutarde.
Peut-être qu’une Mary Poppins sans chanson dans un Hitchcock n’était pas ce que le public voulait voir. Le mystère restera donc entier. Hitchcock lui-même ne s’étant jamais répandu en confidences sur son film, le ventripotent mais très cabotin cinéaste préférant épiloguer jusqu’à plus soif à propos de ses plus grands succès et uniquement ceux-là. Pour Hollywood c’est le dilemme. Que s’est-il donc passé ? Le public ne voudrait voir Julie Andrews que dans des comédies émaillées de comptines un tantinet idiotes ? Remettre un de ces films en chantier est une vraie gageure mais d’un autre côté, si la sauce prend, on parlera immédiatement de millions de dollars de bénéfices. Alors ne dit-on pas jamais deux sans trois ?
C’est Universal qui tente le coup et débloque six millions de dollars pour « Thoroughly Moder Millie ». Une comédie musicale plutôt risquée puisqu’on y parle essentiellement de trafic d’êtres humains et que Julie s’y montre affublée de costumes caricaturaux des années folles.
La sortie du film est prévue en 1967. Alors que le public ne songe plus qu’à la libération sexuelle, le LSD et les comédies policières psychédéliques bourrées de filles en minijupe essayant de nouvelles danses et de nouvelles substances. « Millie » a l’air d’un dinosaure dans un tel climat. Et pourtant l’opération va être invraisemblablement payante ! Le film engrange près de 35 millions de dollars de recette aux USA et il faut en rajouter 40 de plus pour l’exploitation internationale. Universal qui envisage probablement des sanitaires en or massif se frotte le carnet de chèque. Julie Andrews est la money maker numéro un d’Hollywood !
On se l’arrache, tout le monde la veut !
On met presque immédiatement deux superproductions en chantier, des films au budgets illimités. C’est la Century Fox qui ouvre le bal avec « Star » dirigé par Robert Wise.
C’est ensuite « Darling Lili » produit par Blake Edwards. Les deux films feront des fours à la hauteur du succès de Millie ! « Star » perd dix millions de dollars et « Darling Lili » en perd vingt ! Entretemps, nous sommes passés en 1970, Barbra Streisand et Liza Minnelli ont surgi, il semble bien que les jours de Julie Andrews à Hollywood soient comptés. Ils l’auraient été si Blake Edwards avait été rancunier et s’il n’était pas follement amoureux de Julie Andrews !
Divorcée en 1967, Julie a épousé Blake Edwards en 1969 avant le début des prises de vues de « Darling Lili ». Malgré l’échec de leur première collaboration, Blake Edwards s’en inspirera pour le scénario de S.O.B. le couple restera très soudé et Julie Andrews ne travaillera plus qu’à de très rares exceptions pour d’autres réalisateurs. Le couple Edwards adoptera deux enfants, deux filles.
Amy en 1974 et Joanna en 1975. Ces deux adoptions font des Edwards une famille nombreuse puisque outre la fille de Julie, Blake Edwards a lui aussi deux enfants d’un premier mariage : Jennifer et Geoffrey.
Présente au théâtre, à la télévision Julie Andrews ne tournera que deux films dans les années 70. Deux succès mais des succès qui seront à mettre à l’actif de ses partenaires Omar Sharif d’abord et Bo Derek ensuite. Il faudra attendre 1982 et le sensationnel Victor Victoria pour que Julie regagne le haut du box-office et la liste des actrices que l’on nomme aux Oscar. On pouvait alors imaginer l’actrice remise en selle et prête à collectionner les triomphes et les dollars. Pourtant, sans doute échaudée par le traitement qu’Hollywood lui a infligé durant sa longue éclipse au cinéma, il n’en sera rien. On n’est jamais très tendre à Hollywood mais les pires traitements sont réservés aux machines à sous qui s’enrayent. Si elle n’était pas mariée à Blake Edwards, Julie Andrews n’aurait plus tourné saut à se produire elle-même comme Barbra Streisand. Sinon elle était bonne pour la catégorie de films minables où son nom servirait de caution pour obtenir un budget que ni le réalisateur ni le scénario ne méritent telle une Liza Minnelli.
Julie Andrews tourne mais reste rare, choisissant avec soin les films qui la mèneront au succès quitte à perpétrer sempiternellement l’image que le public se fait d’elle. En 1986, elle est à l’affiche de deux films qui sortent simultanément. Dans le premier elle est une mère de famille souffrant d’un cancer, dans l’autre une virtuose du violon frappée par la sclérose en plaque. Ce seront deux fours ! Et puis le destin va se souvenir de toutes les bontés octroyées au fil des ans à l’actrice et se charger de lui faire payer l’addition pour tant de bienfaits en la privant de ce qu’elle a de plus précieux au monde.
En 1997, Julie Andrews souffre régulièrement de la gorge et atteint de plus en plus difficilement les notes hautes. Tous les spécialistes de la voix lui ont toujours diagnostiqué un larynx fragile et lui ont interdit le bel canto pour lequel sa tessiture était pourtant idéalement parfaite. Une opération somme toute bénigne destinée à la soulager va tourner mal et priver la star de sa voix. « Maintenant je chante comme une râpe à fromage rouillée qui tombe au fond d’une poubelle ! » L’erreur médicale est avérée la star est dévastée. « J’ai toujours chanté d’aussi loin qu’il m’en souvienne, je ne sais pas ce que c’est de vivre sans chanter ! C’est ma nature ma passion, mon don, c’est surtout mon métier » A un autre journaliste elle déclare : « J’ai toujours exploré les notes hautes, celles pour chanter la joie, le soleil l’optimisme, je me suis toujours méfiée des chansons tristes qui ne permettent pas d’envolée. Aujourd’hui je suis bonne pour aller me faire jeter des tomates dans un club de jazz de troisième ordre à Harlem et je ne les aurai pas volées ! » ; Plus tard encore elle avouera avoir beaucoup pensé à la mort, sa seule échappatoire ». Elle a d’autant moins d’échappatoires que les journaux colportent des bruits de cancer et que les assurances ne couvrent pas les artistes atteints à Broadway et à Hollywood. Et sans assurances, pas de budgets. Autant dire qu’on vous enterre professionnellement immédiatement dès l’annonce de votre maladie. Julie Andrews intentera un procès tonitruant aux médecins qui l’ont moralement et professionnellement tuée. Un procès qui se réglera à l’amiable sans que personne ne révèle le montant des dommages et intérêts.
Julie retrouvera sa voix. Ou plus exactement une voix, une autre voix plus fragile, plus modeste mais qui lui permettra d’encore chanter et surtout d’encore travailler. On la verra d’ailleurs de plus en plus à la télévision où les tournages sont moins longs, moins éprouvants, elle prêtera également sa voix à plusieurs films où elle n’apparaît pas comme la série des « Shrek ».
Et puis en 2010, l’autre coup fatal : Deux semaines avant Noël, Blake Edwards son compagnon, son collège, son ami, son mentor la laisse veuve après 40 ans de mariage. Dévastée, Julie prendra sur elle comme la battante qu’elle a toujours été et reprendra les chemins des studios. Studios où elle ne pointe pas tous les jours, c’est une chose certaine mais qu’elle n’a plus désertés.
QUE VOIR ?
1964 : Mary Poppins : Julie Andrews surgit sur les écrans en nurse magique de l’époque victorienne. C’est le plus gros succès Disney de tous les temps et les effets spéciaux les plus réussis de leur époque ! La nurse enchantée rafle d’emblée un Oscar très mérité.
1965 : The Sound of Music : Que dire encore de ce film ?
1966 : Torn Curtain : Julie Andrews dirigée par Hitchcock avec Paul Newman derrière le rideau de fer. Une alléchante promesse, un échec commercial plutôt inattendu.
1967 : Thoroughly Moder Millie : Pastiche des comédies burlesques des années folles, fusillade dans China Town comprise sur fond de traite des blanches et de shimmy. Les plus fins observateurs remarqueront sans peine que Mary Tyler Moore n’a aucun mal à voler quelques scènes à miss Andrews.
1968 : Star ! Robert Wise met en scène Julie dans un biopic consacré à Gertrude Lawrence. Julie Andrews craignait de se frotter à miss Lawrence qui avait été une star absolument gigantesque. Mais la Century Fox était sûre du succès et qui de plus est, Julie leur devait un film. La Fox persista malgré les exigences de Julie : Un million de dollars, un pourcentage sur les recettes et sur les albums de la BO. Hélas comme le craignait Julie, le film fut un bide complet. Certains critiques quittèrent la salle avant la fin de la projection le soir de la première et l’un deux commenta : "Si vous aimez Julie Andrews allez-y, si vous aimez les comédies musicales démodées allez-y, si vous savez qui est Gertrude Lawrence, restez chez vous !" Le film sera nominé pour 7 Oscar et n’en remportera aucun.
1970 : Darling Lili : La première collaboration du couple Julie Andrews Blake Edwards. En fait une vague resucée musicalisée de Mata Hari avec Rock Hudson aux prises avec l’espionne chantante et Mary Poppins dans un striptease ! Le film perdra quand même 20.000.000de dollars !
1974 : The Tamarind Seed : Il aura fallu quatre ans pour retrouver Julie Andrews à l’écran dans son seul succès de la décennie, lequel est porté par Omar Sharif alors au sommet du box-office avec Docteur Jivago, Funny Girl et Lawrence d’Arabie.
1979 : 10 (Elle) Le film fut une véritable révolution. Sa vedette féminine Bo Derek, madame John Derek à la ville comme son nom l’indique devenait en un film une star planétaire et l’avant dernier sex-symbol hollywoodien avant Sharon Stone. Bo était la Marilyn saine et sportive que les années 80 s’étaient choisie.
1981 : S.O.B. Julie Andrews qui est devenue ce que Stéphane Audran aurait appelé « la brosse à dents de Blake Edwards » ne tourne plus guère qu’avec lui. Le scénario de cette comédie noire montrait un producteur à succès se remettant mal de l’échec de son dernier film persuadant son épouse actrice oscarisée de tourner un porno soft.
1982 : Victor, Victoria : Il n’est pas possible pour une star telle que Julie Andrews de terminer sa carrière sans un baroud d’honneur qui la remettra au sommet pour l’éternité des siècles ! Elle aura son « Sunset Boulevard » avec cette comédie très soignée signée …Blake Edwards. Remake d’un film allemand de 1933 avec Renate Müller dans le rôle, le film sera nommé sept fois aux Oscar. Seule la musique sera couronnée. Julie bien entendu nommée sera évincée par Meryl Streep pour « Le Choix de Sophie ».
1983 : L’homme à femmes : Blake Edwards reprend le film de Truffaut « L’homme qui aimait les femmes » et le triture pour en faire une comédie pathétique à souhait.
1986 : That’s Live : Julie dans une pseudo comédie dramatique et matrimoniale de Blake Edwards dont le seul intérêt est le couple qu’elle forme avec Jack Lemmon. Une rencontre qui arrive 20 ans trop tard. Personne ne croyant au projet, une Julie atteinte du cancer, le couple Edwards tournera dans sa propre maison et bouclera le tournage avec deux millions de dollars. Moins qu’un spot publicitaire Chrysler.
1986 : Duet for One : Julie, violoniste virtuose découvre qu’elle est atteinte de sclérose en plaques à quelques jours d’un prestigieux concert. On pourrait s’attendre à un mélo qui nous tire une larmichette bien malgré nous, comme quand E.T. retourne sur sa planète maison. A force d’invraisemblances du plus haut comique, genre le mari chef d’orchestre qui rentre de tournée avec sa secrétaire enceinte, on aurait plutôt envie de rire.
1992 : A Fine Romance (Cin Cin) : Comédie romantique inattendue réunissant Julie Andrews et…Marcello Mastroianni.
2001 : The Princess Diaries : Revoici Julie la tête couronnée pour une comédie avec Anne Hathaway.
2004 : The Princess Diaries 2 : Royal Engagement : La suite de l’autre.
2010 : Tooth Fairy : Une comédie fantastique très « film de Noël » où Julie est la chef des anges gardiens et recrute un joueur de hockey sur glace.